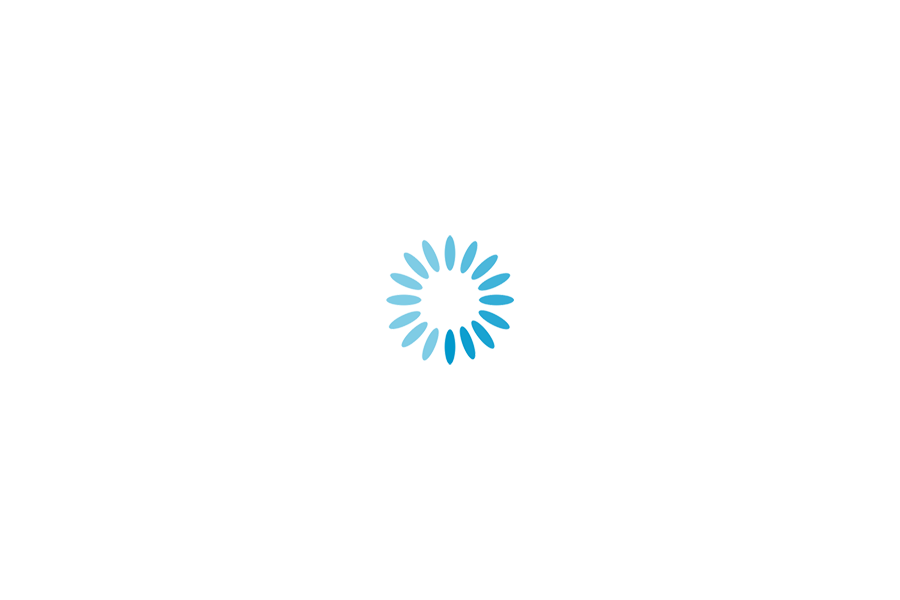Le Dr Fridolin Nke, enseignant de philosophie à l’université de yaoundé 1 répond aux professeurs Mathias Eric Owona Nguini et Joel Meyolo.
Il s’agit d’une querelle débutée il y’a quelques jours après le texte intitulé « la communauté des captifs » du Pr Achille Mbembe à la suite de laquelle le Dr Fridolin Nké n’a pas digéré les critiques à lui faites par les Pr Owona Nguini et Joel Meyolo.
Publié par ABK Radio
CE QUE MÉON DOIT COMPRENDRE, CE QUE SES GUÉRILLEROS DOIVENT SAVOIR
Ou « L’AFFECTÉ ET L’ÉRUDIT »
Un monument de la science politique, Mathias Éric Owona Nguini (MÉON), s’est senti mal en point après avoir lu ma réaction portant sur la polémique qui l’oppose à Achille Mbembe, en coaction avec Fame Ndongo. Il a cru que je parlais des affaires de l’école. La vie se résume-t-elle aux vantardises académiques ? Il s’est imaginé, que non seulement j’émettais des doutes au sujet de ses gros et décourageants diplômes, mais aussi je constituais un régiment d’ « aigris » pour lui ravir son Professorat, gagné pourtant de longue lutte, à l’éther du mérite, au bout de son long Chemin de Damas, à l’Université de Soa.
Il n’en est rien. Je traite des idées du citoyen Owona Nguini ; je m’interroge sur ses valeurs, la qualité de son goût, ses références doctrinales et l’impact de ses fréquentations idéologiques et politiques sur son intégrité et ses responsabilités d’universitaire.
« Ce qui préoccupe un penseur digne de ce nom, c’est l’avenir commun, quelles que soient l’appartenance politique, l’origine ethnique, les convictions idéologiques, les convenances de goût, les orientations religieuses, etc ».
Ce dont je parle, c’est de notre implication sociale en tant que chercheurs et enseignants du supérieur. Ce qui m’intéresse dans les tribunes que je publie, ce n’est pas de savoir si untel a obtenu un, deux, trois doctorats ou cinq professorats, ni non plus si cet autre est de telle origine culturelle ou de telle tribu. Je me demande toujours si celui qui parle, ou dont je parle, travaille à la pérennisation du statut quo criminel (à ce que la misère et la mort se propagent bien) ou s’il œuvre à l’avancement du pays. Ce qui préoccupe un penseur digne de ce nom, c’est l’avenir commun, quelles que soient l’appartenance politique, l’origine ethnique, les convictions idéologiques, les convenances de goût, les orientations religieuses, etc., bref, ce que les êtres humains rencontrent comme difficultés, au quotidien, et le travail théorique et technologique qui nous attend, non seulement pour nous faire respecter dans le concert des nations comme un peuple fier de lui-même, mais aussi pour garantir un développement soutenu de notre économie et de notre culture en tant qu’Afrique en miniature.
Certes, dans le précédent texte, j’analysais la posture politique de MÉON, un universitaire accompli. Je faisais la peinture des saillies de sa figure de leader (supposément incontesté) des sciences sociales, ainsi que la pertinence et les enjeux de ses interventions sur la scène du cauchemar politique que nous vivons au quotidien. Cette exécution picturale (le fait que je le dessine ainsi, en public, avec une telle impertinence) peut dérouter et agacer en même temps. Je comprends que MÉON s’en émeuve tant, et qu’il sombre dans l’insulte, la condescendance et l’argument d’autorité ; qu’il me traite de « sous-idéologue douteux », de « Péquenot », de « pubertaire de la pensée », de « paraphilosophe imprécateur », etc.
Il a, d’ailleurs, reçu du renfort. Un adepte de sa chapelle de la stigmatisation tribale, qui, jadis, acquit une médiocre réputation pour avoir fondé la philosophie de l’anatomie pointue du « sexe de l’État » (c’est le titre de son livre), me range parmi les « groupies » !
Un autre quidam, Professeur de l’ignorance crasse, Maître de Conférences confirmé de l’épatement, enseignant au Département d’histoire de l’Université de Yaoundé I, faute d’arguments scientifiques opposables, s’est enfoncé davantage dans son crétinisme réputé et a complété le tableau de sa nudité intellectuelle en vociférant au sujet de mon identité ethnique. C’était plus fort que lui ! Je mesure le courroux que mes écrits suscitent chez ce stipendié ténébreux, injecté dans l’académie pour espionner le secteur d’authentiques historiens ; je mesure l’ampleur de ses étourdissements et l’extinction subite de son étoile empruntée à son « piston » : le mage de la déperdition scientifique, expert en intrigues et couvé aux endormissements des passe-droits, désespère d’exister comme universitaire confirmé, malgré tous ses grades ronflants. Le bonhomme joue au bourgeois, le bourgeois indigène, l’arriviste de la derrière heure. Et, comme tous les bourgeois, il fait le mal par devoir ; il tue par principe ; il aspire à imposer ses compétences académiques et pédagogiques illusoires à grands renforts de cynisme et de prétentions.
Ce personnage ordurier, venu de nulle part et sorti de partout, de tous les campus du pays, pour échapper à son incapacité à s’établir en un lieu identifiable propice à une formation rigoureuse et suivie, ainsi que les usages académiques le consacrent, ne manque cependant pas l’occasion de commettre les sept péchés capitaux rituels des petits clercs, dont les instincts les plus grégaires commandent à la lucidité élémentaire : « La paresse dans l’exercice de l’injustice ; l’orgueil de montrer le meilleur de soi-même (refus de se vendre) ; la colère contre la vilénie ; la gourmandise (manger selon sa faim les produits de son travail) ; la luxure (l’amour désintéressé) ; l’avarice dans la pratique du vol et de la tromperie ; l’envie envers les gens heureux . » Au sujet de cet imposteur malhabile, je me contente de plaindre ceux qui l’ont élevé, frauduleusement, au firmament académique de la science historique et les étudiants en histoire de l’Université de Yaoundé I, ces génies qu’un évaporé se charge d’affubler (dénaturer) impunément.
Mais laissons ce goujat à ses turpitudes et revenons au gourou en chef, MÉON. C’est, d’ailleurs, le seul parmi eux qui mérite mon intérêt ; c’est l’unique proie qui peut contenter, provisoirement, mon insatiable boulimie critique.
MÉON m’accuse de manquer de courtoisie. Je me justifie dans la première partie de ma réponse (I). J’en profite pour assumer l’identité de « pubertaire de la pensée » qu’il m’attribue (II) et pour questionner en profondeur son écriture et sa politologie immorale (III). Enfin, puisqu’il soutient que je trahis la cause patriotique, comme Mbembe, en refusant de venir défendre le Grand-père au pouvoir, le « sage » du village, contre les méchants Blancs, je lui fait des objections précises à ce sujet, en revenant sur la problématique de la trahison de l’intellectuel et sur la nécessité dans laquelle nous nous trouvons de les sauver, lui et tous les larbins de son espèce, du naufrage de la haine (IV).
I/ Ma réponse à l’accusation de manquement à la courtoisie
Je précise, d’entrée de jeu, que je ne connais pas Achille Mbembe. Je ne lui ai jamais parlé. Je l’ai lu, mais je n’ai jamais lu un de ses livres de la première à la dernière page. Ses affaires, ses méthodes, ses connexions ne me concernent en rien. Mais j’examine ses idées et les arguments des uns et des autres sur la place publique ; je participe au débat républicain (pas à la querelle puérile de l’agité sur les crises de démence dont souffrirait le frère d’un contradicteur pugnace). Comme MÉON, j’affectionne particulièrement le combat d’idées.
MÉON me reproche « d’utiliser la langue pour détruire l’ennemi idéologique ». Ai-je vraiment le choix ? puis-je faire autrement ? Lui-même sait que les mains rugueuses de la vertu ne connaissent pas les caresses. Dans Le savant et le politique, Max Weber met en avant la rigueur punitive de l’exemplarité à quoi nous sommes astreints, de par notre statut social de pédagogues de l’honnêteté et de forçats du progrès social. Weber écrit : « Tu dois t’opposer au mal par la force, sinon tu es responsable de son triomphe ». Que le lecteur ne s’attende donc pas à ce que je sois bienséant, tendre, courtois et cordial avec les cyniques, les imposteurs malfaisants, les théoriciens de génocides, les gouvernants corrompus et leurs laquais renfrognés dans le crime et d’indécrottables vices. Quelle courtoisie peut-on afficher à l’endroit des gens dont la conviction intime est que la force peut tout, la justice rien ? On est comptables des bonnes mœurs lorsqu’on est en face des personnes respectables. C’est fort de cette évidence que je m’autorise à ne pas respecter l’imposture et l’immoralité par les armes de l’impertinence critique.
MÉON, cette intelligence pétillante, a choisi de ne plus être un homme, tout court. Naguère disciple de la connaissance, il ne s’est même pas contenté de se mettre au niveau de l’Africain, encore moins au niveau du Camerounais : il s’est convaincu qu’il est désormais, exclusivement, EKANG, c’est-à-dire l’incarnation des hérésies de l’anthropologie coloniale ! Et il s’y est résolu. Tous ses doctorats et ses professorats sont mis au service d’un pigment imaginaire, d’un sortilège tribal ! Dans ces conditions, fort de ce qui précède, n’est-il pas dit que le Ciel exige davantage à ceux qu’Il a comblés de son génie créatif et de sa miséricorde ? Les philosophes, ces prédicateurs de vertu, prennent le relais pour contraindre les créatures les plus prometteuses à mettre ces énergies positives, reçues gracieusement de l’Éternel, au service de toute l’humanité.
Leur discourtoisie à l’égard des esprits malveillants est l’ultime marque de respect envers l’humanité qu’il porte en eux, malgré eux. Ils traitent avec déconsidération tous ceux qui mettent leur intelligence et leur génie au service des causes qui heurtent l’âme. Certes, les esprits moins palabreurs leur tiennent rigueur de leur effronterie. Mais, comment ne pas les comprendre lorsque l’intelligence enivrante qui a bercé leurs ambitions juvéniles se transforme en la menace la plus imminente de la sécurité commune ?
L’expert en discernement a le devoir républicain de les terroriser pour leur éviter la damnation en quoi consiste l’abime du confort indigne. C’est que, contrairement aux citoyens ordinaires, il a cessé d’être ce qu’on avait fait de lui, à savoir, l’animal patient, résigné et respectueux de n’importe qui. Désormais, l’aigreur, l’invective et l’anathème ne représentent rien sur l’échiquier de ses réquisitions torrides. Il ne se contente plus d’être discourtois envers les méchants, puisqu’il se rend à l’évidence que la courtoisie est la qualité du doute qui passe pour un péché. Par rapports aux détourneurs d’espoirs, il se fait plus amer : il ne lui suffira plus de les déconsidérer ; il apprendra à les désaimer. Les incivilités de la langue ne le satisferont plus ; il entreprendra de les haïr. Le peuple, lui, se transformera en des millions de parasites intestinaux (le ténia, de préférence), pour venir habiter leurs volumineux estomacs et les dégarnir du jus des prébendes, de la prévarication et de la concussion qui en sont l’ignominieux contenu. L’ère des lycaons providentiels est révolue. Le temps n’est pas à l’amour, ni au pardon ; il est à la clairvoyance et à la justice !
II/ L’argument-massue du « pubertaire de la pensée » et la revanche de l’ « enfant »
La candeur juvénile est la digue la plus infranchissable pour éviter de sombrer dans la barbarie sénile, dont nous faisons actuellement l’expérience. MÉON aurait lu la parabole de la métamorphose de l’esprit, « comment l’esprit se change en chameau, le chameau en lion, et le lion en enfant », il n’eût certainement pas recouru à ce risible expédient rhétorique de « pubertaire de la pensée », qu’il assimile à la plus dégradante insulte à mon endroit ; il eût reconnu l’inconsistance de ses envolées lyriques qui ne font pas le poids avec la fonction de systématisation de la figure de l’enfance dans des système philosophiques les plus aboutis, celui de Nietzsche, en l’occurrence.
Expliquons, en quelques mots audibles pour une sensibilité et un entendement gauchis, cette parabole des mutations de l’esprit, qui s’irréalise en même temps comme un chameau, un lion et un enfant. Nietzsche montre qu’un grand esprit a la responsabilité de porter « de lourds fardeaux, les plus lourds fardeaux qui soient », d’assumer les responsabilités les plus exigeantes au profit de tous les autres, au point de « boire une eau bourbeuse, si c’est l’eau de la vérité ». Il se dispose ainsi, par son endurance, son humilité et son intrépidité, à mieux jouir de sa force, pour renverser tous les obstacles, dominer toutes les prétentions, anéantir tous les impératifs des moralistes vendus qui tuent le peuple, triompher des faux forts, vaincre tous les adversaires de l’homme et régner sur l’espèce, comme le lion parmi les animaux. Cette ascension spirituelle et morale le prédispose, enfin, à se régénérer en permanence, à reboiser le désert de l’homme, et à ensemencer une humanité moins viciée, en somme, à créer de nouvelles valeurs pour renaître de nouveau et se perpétuer comme une flamme sacrée : c’est l’enfant !
MÉON, je sais, n’y voit que du feu. Il me demande, à l’instant : « Mais, dis-moi, mon frère, que peut encore l’enfant, dont le lion lui-même eût été incapable ? Pourquoi le lion ravisseur doit-il encore devenir enfant ? » Je m’oblige à répondre, à cet « enfant » égaré parmi les octogénaires insensibles, en empruntant la voix austère du Maître, Nietzsche : « C’est que l’enfant est innocence et oubli, commencement nouveau, jeu, roue qui se meut d’elle-même, premier mobile, affirmation saine ». Cette nécessité de cesser de devenir vieux, de vouloir son propre vouloir et d’arrêter de s’assimiler aux vieillards et aux râblés qui tuent, MÉON ne l’a pas expérimentée encore ; il n’en a pas mesuré la pleine portée et les fonctionnalités.
À notre grand désarroi, MÉON s’est laissé avoir par les arguments du Lion d’Étoudi et ses courtisans malhonnêtes. Et il n’y est pour rien. Tel, il fut formé, à ne point regarder les ressorts théorétiques de la codification positive du droit et de la loi ; il fut dressé pour oublier que la politologie s’institutionnalise au cœur des élaborations philosophiques qui sous-tendent leur ordonnancements et leur donnent toutes leur densité et leur accréditations scientifiques. Les rudesses de la lutte qu’il a engagée, en ligne, contre la meute, l’ont déterminé à jouer au plus fort, à se prendre pour l’évolué par excellence des Ekang, et à jubiler, suite à son élévation présidentielle aux hautes fonctions de Monsieur Patron des rabougris, comme L’enfant peul d’Amadou Hampâté Bâ, qui confiait : « Le plus grave est que, tout à coup, je me sentis bêtement fier de moi-même. Coiffé de mon casque colonial, oubliant pour un instant mon statut d’écrivain temporaire à titre essentiellement précaire et révocable, je me prenais pour un grand chef… »
Comme Amkoullel, MÉON s’est convaincu, depuis quelques années, qu’il ne faut rien prendre au sérieux (y compris lui-même), sinon ce faux goût de la fraternité Ekang, c’est-à-dire, concrètement, cette température ubuesque et sénile qui fait et défait les destins impitoyables des Camerounais. Il a cru que l’école, le travail de l’universitaire en l’occurrence, est une rentable farce qui permet de se sauver de la conscience originellement exigeante, pour mieux piétiner la vie des citoyens ordinaires, les crédules, les niais et toute l’engeance des simples de cœur, qui, depuis longtemps, ont renoncé à interroger leur présent et à s’inquiéter de leur avenir. Il contribue, au travers de son intempérance vindicative, à la dégénérescence de la conscience nationale. Il ne se rend pas compte que le magnétisme de la haine est doux ; que cette douceur est foncièrement avariée.
Quel insensé, ce MÉON !
Voilà un lumineux atout qui a dérivé vers la plus détestable rancœur. On retiendra, de cette monumentale perte, que se contenter de paraître Grand dans la vie ne suffit pas : il faut s’efforcer de ne pas perdre dans sa bouche le goût juvénile de la vérité, la spontanéité, la sincérité, l’intrépidité, l’empathie et la liberté de conscience, qui font véritablement le Grand Homme, c’est-à-dire une opportunité immense pour l’humanité toute entière.
III/ MÉON : l’écriture de la déroute et la politologie immorale
Cependant, je concède à MÉON cette immaturité dans la manipulation des concepts philosophiques. Les gens n’aiment pas traverser les abris barbelés de leur suffisance, ni non plus les frontières de leurs peurs ; très peu d’universitaires sont capables de s’aventurer dans des domaines qui ne sont pas les leurs ; beaucoup redoutent de perdre leurs assurances espiègles au contact de la plus exigeante demande de systématisation du regard, comme c’est le cas dans certaines disciplines comme la philosophie, certaines spécialité du droit, etc. Je parle de la vraie philosophie, pas des épouvantails de certains de mes anciens enseignants, qui étudient le sexe de l’État, la puberté de la constitution, la défloraison des voitures administratifs et d’autres balivernes qui ne méritent pas d’être retenues comme des pensées élaborées. Je ne convoque pas ces figures philosophiques dépravées, très tôt retraitées, à leur goût, et qui rêvent en permanence de la jouissance des ministres, avec l’espoir d’en jouir dans le vrai jour, à leur tour. J’évite surtout de me référer au discours insipide qui demande de regarder les étoiles de la vie, l’excellence humaine, et de dédaigner l’avoir et les biens matériels, qui, pourtant, sont indispensables à la pensée.
En revanche, ce qui rend MÉON irrémissible (impardonnable), c’est la culture du cynisme dont il est désormais le théoricien attitré. Lorsque j’entendais parler de MÉON, en Terminales, je m’imaginais une déité perchée sur la cime du savoir universitaire. Je me le représentais sous les traits harmoniques de LA référence scientifique inaltérable, qui surplomberait le Mont Cameroun, avec tout le prestige et le panache qu’il charrie de nature, en guettant en permanence en contre-bas, au loin, dans la plaine étalée, par la force de la perspective plongeante, les trémoussements putrides des ombres humaines. Parvenu à l’université, je découvre que mon dieu s’est dégradé en un épouvantail, l’éventail que le pouvoir s’est fabriqué pour souffler dans son visage, liquéfié par des parjures à répétitions, afin de prendre un peu d’air, dans l’environnement étouffant de l’inertie criminelle qu’il entretient depuis quatre décennies. Avant que je n’aie entamé l’ascension de quelque hauteur que ce soit, pour communiquer avec l’Esprit (je suis honnête, je n’ai pas de références, aucun bagage, JE SUIS PERSONNE), l’ombre altière d’hier s’est transformée en un chameau pathétique. Je retrouve mon Chameau au plateau, au plateau du Golan, où des Israéliens (au pouvoir) et des Arabes (dans l’espoir) nègres, en miniature, se défoncent sans vergogne. MÉON, lui, s’accommode de cette terre de séparations, de ce terrain stérile et maudit des palabres génocidaires. Le dieu est déchu, mon dieu s’est perdu, à cause de ses propres turpitudes. Il se vautre désormais dans la boue, une boue maculée de sang, la boue de la mort de la conscience citoyenne.
« Il se bat pour retrouver la lucidité, mais la mauvaise foi prévaut, pourtant. Il est réduit à réaménager sa cachette. Ses mots manifestent sa déroute sentimentale et intellectuelle. »
D’où la prolixité cadavérique de MÉON, d’où son langage cacophonique, d’où son écriture inclassable, qui est incompatible avec les référencements académiques classiques (je veux dire qu’aucune formation, même dans l’école de guerre, même lorsqu’on apprend au médecin à cacher sa mort au damné, ne peut conduire celui qui en sort à écrire ainsi). Il fait valoir qu’il entretient des rapports spécifiques avec les mots. Il n’en est rien : parler, écrire, pour lui, désormais, c’est se cacher ; c’est mettre la main sur son visage tuméfié par l’opprobre, défiguré par la compromission et la discrimination, pour mieux dissimuler le spectacle de la honte dont il est la scène. Il se bat pour retrouver la lucidité, mais la mauvaise foi prévaut, pourtant. Il est réduit à réaménager sa cachette. Ses mots manifestent sa déroute sentimentale et intellectuelle.
Je comprends aisément qu’il me reproche ma « révérence a-critique pour les modes intellectuels qui viennent et vont en Occident » ; je conçois la nécessité dans laquelle il se trouve de critiquer mon manque d’indépendance d’esprit supposé, et qu’il mette en avant la « dépendance épistémique sans limites » envers les gadgets du post-modernisme » (qu’il n’explique pas, ni ne systématise). Je remarque qu’il s’offusque que je dénonce l’état piteux de nos universités et l’absence de structures de recherche en leur sein, et, enfin, qu’il recourt aux arguments spécieux contre ma personne. C’est ainsi qu’il s’attaque à mon intégrité morale, en mobilisant le passif des calomnies et de la diffamation auxquelles un certain Professeur a recouru comme son arme de prédilection pour neutraliser les Assistants et Chargés de cours énergiques et libres d’esprit. Cet égaré, débordant de jalousie et de haine, et qui était parvenu à la chefferie du département et du décanat, par l’insensé pouvoir discrétionnaire, en a été chassé depuis lors, à cause de ces nombreuses bourdes…
Mais que MÉON me comprenne, à son tour : sa nébuleuse versatilité idéologique et son éthique politique contingente seraient considérées, par n’importe quel laboratoire du discernement, comme des cas inédits à analyser. Le relief de son décentrement immoral, par rapport aux réquisitions élémentaires du bon sens et du sixième sens, interpelle en effet ma science du voir et du comprendre (je veux dire que, même quand quelqu’un n’est pas allé à l’école des superlatifs, comme lui, ce que MÉON dit, comment il l’écrit et agit, toutes ses idées en somme, désormais, mettent mal à l’aise l’observateur et suscitent le doute hyperbolique de Descartes). Je continue de me demander s’il est digne de siéger dans la mémoire des générations futures ou s’il est bon pour l’oubli.
IV/ La trahison de l’intellectuel et la nécessité de récupérer les nôtres
MÉON me qualifie de comprador, le traître à la solde de l’étranger, le déraciné qui s’est mis au service du néo-libéralisme et des puissances d’argent. La question à laquelle il me contraint de répondre, en mon âme et conscience, est la suivante : suis-je au service des intérêts étrangers parce que je dénonce la malgouvernance dans mon pays ? La réponse est négative. Celui qui aspire à défendre l’humanité ne choisit pas, à la légère (arbitrairement, en fonction de ses émotions, de ses affects, de son pathos), ceux qu’il veut défendre et ceux que l’on doit pendre sans conséquence. « L’exemple de ce que doit être un homme : ami fidèle, militant courageux, ennemi sans faiblesse des ennemis de l’homme », tel est l’éthique existentialiste développée par Jean-Paul Sartre . Nous assumons cette posture, parce que la vérité ne connaît pas les frontières des hommes.
L’inverse de cette question, que je me réserve de formuler, en temps opportun, est celle-ci : participe-t-on à la prospérité nationale, en servant docilement le pouvoir de la peur, en place, sous le prétexte du patriotisme et du combat pour la défense de la souveraineté nationale ? Et, subsidiairement, que vaut une souveraineté qui n’est pas adossée au développement économique ?
Les Blancs pillent en amont, soit. Sont-ce eux qui, en aval, ont tué toutes nos sociétés, ont pillé la fortune publique, la CAMAIR, etc. ? Sont-ce eux qui refusent d’équiper les hôpitaux en plateaux techniques et qui continuent de mobiliser des milliards de francs en évacuations sanitaires et dans la guerre au NOSO ? Sont-ce eux qui manipulent les résultats des concours administratifs, au profit d’une minorité dérisoire de la population, et qui nomment les membres d’un seul clan et quelques familles privilégiées, assimilées, comme celle des Owona, aux plus hautes fonctions du pays et à tous les postes-clés de l’administration publique ? Sont-ce eux qui vous empêchent d’industrialiser le pays et de financer la recherche universitaire pour faire décoller l’économie nationale ?
L’essentiel de l’affaire se trouve ici : un mauvais vent souffle sur notre pays, surtout depuis les désillusions qui ont suivi l’apothéose de 1982. Le régime a entrepris de liquéfier le cerveau de nos génies les plus prometteurs, consignant du même coup leur jugement et leur liberté d’esprit aux bornes de la déraison. Fondamentalement, ce n’est donc pas à MÉON que je m’en prends. Je combats ceux qui nous l’ont volé, tous ceux qui l’ont entaché de cette déformante et lugubre vieillesse spirituelle et de goût qui le rend désormais infréquentable.
Au crépuscule de ce régime infernal, nous devons commencer le travail de récupération de tous les nôtres. Ils seront, pour la plupart, des vieux équipements, des meubles vieillis par l’obsolescence d’un pouvoir parasite et sclérosant. Mais, au moins, ils serviront comme objets précieux du musée de nos souffrances. MÉON, désormais, est une vieille pièce d’une collection ancienne qui tomberait dans l’oubli si l’on ne l’exorcise illico. Ce faisant, on le revalorise en fixant un prix exorbitant qui lui redonne une valeur inespérée, un regain de bon sens en somme. À condition qu’il ne pèche pas trop…